Texte qui accompagne l'exposition de Club Superette à Station V, Bayonne, novembre 2024
« Les vers ne sont pas humains. Leurs corps ondulent, atteignent, prennent et ingèrent, et leurs excréments fertilisent les mondes. 1»
Enfant, sur la plage, je faisais couler inlassablement le sable détrempé depuis mon poing fermé afin de former une petite tour constituée de l’accumulation des gouttes sablées. Plic. Ploc. Je retirais beaucoup de fierté lorsque ces cathédrales s’élevaient enfin à quelques centimètres de haut, fragiles Sagrada Familia, baroques et instables. Je n’ignorais pas les vers qui, à mes pieds, semblaient effectuer un travail similaire, depuis le sous-sol, comme en miroir : le chorre de l’océan descendant révélait une multitude de petits tumulus formés par ces animaux au corps mous se tortillant dans les galeries sableuses. J’apprends aujourd’hui, grâce au collectif d’artistes Club Superette, qu’on nomme ces pyramides des « turricules », soit « petite tour » – du latin turris, « tour », et du suffixe diminutif culus. Ils ne sont pas l’apanage des seuls vers marins : les vers de terre dits anéciques en produisent également. Ces invertébrés vivent au sein de galeries débouchant à la surface du sol ; iels n’explorent celle-ci qu’en pleine nuit, pour se protéger des prédateurs, la queue toujours enfoncée dans la galerie en vue de se rétracter instantanément. Car la principale activité de ces bestioles consiste à patiemment enfouir des débris végétaux afin qu’ils se décomposent, puis de les ingérer avec de la terre. Les tortillons ne sont rien d’autres que leurs déjections : l’humus passe dans le tube digestif du lombric avant d’être expulsé au niveau de l’anus, s’accumule à la surface du sol et forme un petit tétraèdre de compost.
Dans l’exposition Wormcast a spell, Club Superette invite à admirer les turricules consciencieusement récoltés lors de balades dans la réserve naturelle d’Abbadia – près de NEKaTOENEa où iels sont en résidence – comme le feraient des curateur*ices allant à la rencontre d’artistes pour choisir quelles œuvres exposer. Iels les ont disposés sur de longs socles en grès spécialement conçus pour les accueillir, montés au colombin, évoquant la forme des galeries creusées par les vers. Voici les tourelles de déjection magnifiées, érigées au rang d’œuvres d’art. Je me remémore alors ces instants estivaux de mon enfance. Dans l’exposition comme sur la plage, deux résultats d’activité se côtoient. L’un que l’on qualifierait bêtement de « naturel », à savoir celui des vers de terre, et l’autre de « social », celui des humain*es. Or non seulement la distinction nature/culture est depuis longtemps largement remise en question mais, de plus, on est en droit de se demander pourquoi l’art serait un privilège humain ? En quoi ne serait-ce pas une activité commune aux êtres qui peuplent la Terre ? Les turricules pourraient dans ce cas être envisagés comme le grand œuvre de quelques vers invités ici à exposer. Accepterait-on pour autant de considérer leurs excréments comme autant de sculptures ? Qu’est-ce qui nous en empêche ? s’exclament en chœur Marie Glasser et Mattéo Tang.
Ne pas imiter la nature, refuser la distinction
Pendant deux millénaires, on a cru que la réponse ultime de ce que l’humanité peut faire dans le monde et au monde, avec les capacités qui sont les siennes, avait été donnée par Aristote lorsqu’il énonce que l’art est imitation de la nature. « Il avait ainsi défini la notion à laquelle les Grecs avaient recours pour saisir dans son ensemble la capacité humaine d’action sur le réel : la notion de technè2 ». L’« art », selon Aristote, consiste « d’une part à accomplir, d’autre part à imiter [le donné naturel]3 ». Si l’on se rapporte à la digestion et à son résultat, il y a dans l’histoire de beaux exemples de tentative d’imitation de cette donnée. Le canard de Jacques de Vaucanson en est un. Imaginé en 1738 par le mathématicien et inventeur français qui lui donna son nom, l’animal tout en cuivre doré était capable de manger, digérer et... déféquer. Si Vaucanson s’est beaucoup étendu sur la construction des ailes, leur exactitude anatomique et la diversité des mouvements, il est moins disert sur la mécanique de la digestion. Il précise néanmoins qu’elle l’imite en trois choses : « avaler le grain », « le macérer, cuire ou dissoudre » et « le faire sortir dans un changement sensible4 ». Il s’avère en réalité que les crottes de canard étaient faites de chapelure détrempée teinte en vert olive, stockées dans un récipient séparé et expulsées au moment opportun. L’imitation n’en était pas moins saisissante.
Largement inspirée du canard de Vaucanson, Cloaca (2000) est une autre tentative d’imiter le mécanisme naturel d’assimilation des aliments, aboutissant inexorablement au rejet des excréments. Cette œuvre de Wim Delwoye prend la forme d’un gigantesque tube digestif de 12 mètres de long et 2 mètres de haut, cette fois-ci parfaitement fonctionnel. L’artiste a travaillé avec des scientifiques et des ingénieur*euses afin de réaliser cette machine de verre contenant différents sucs pancréatiques, bactéries et enzymes. Une façon de renvoyer l’humanité à sa part la plus primaire, la plus essentielle, la plus basique : manger, déféquer. « Les toilettes sont un lieu qui révèle notre vulnérabilité. Nos semblants sociaux n’y ont plus cours, l’être humain y redevient totalement animal : à cet instant, notre cerveau ne peut que prendre acte que l’être humain n’est juste qu’un animal.5 » Tentative de rappeler à l’hybris humaine sa basse appartenance au règne animal, ce tube digestif n’est pas sans évoquer un gigantesque ver de terre. Mais en mettant sous vide puis en vendant les crottes produites au prix de 1000 dollars, l’artiste cherche avant tout à créer un appareil totalement inutile et à condamner par l’absurde le système capitaliste. Machine cynique s’il en est, on est loin des préoccupations de Club Superette. Ces dernier*es souhaitent en effet rendre les turricules à la terre afin de ne pas dénaturer un cycle vertueux. Nulle imitation ici ; le collectif ne se substitue pas à Dieu, ne cherche pas à recréer la « nature » ou à l’imiter. Iels invitent les vers à exposer le fruit de leur dur labeur et présentent les turricules tels quels sans en revendiquer la maternité, avant de les restituer à leur contexte initial. Nature et culture sont ici considérées comme des « coconstructions indissociables » – pour reprendre les termes de la philosophe et historienne des sciences américaine Donna Haraway. Elle préfère le concept de « natureculture », qui ne renvoie ni à l’unité ni au duo, mais au multiple, « une sorte de nœud tentaculaire où s’enchevêtrent les vivants, les morts et toutes les choses terrestres6 ». Wormcast a spell refuse la distinction entre deux entités profondément soudées, au profit d’un entremêlement du grès et du turricule, de l’art et des déjections, de l’éphémère et de la poésie.
De la merde comme matériau des beaux arts
J’imagine qu’exposer des merdes de vers heurte la sensibilité d’amateurices de l’art attaché*es à la chose noble. Peut-être faudrait-il leur rappeler que cela fait maintenant 80 ans qu’en Occident les déjections ont été envisagées comme matériaux potentiels à l’œuvre d’art. La critique Camille Paulhan a fait un long travail d’historisation de cela, de Gaston Chaissac, qui exposa une Composition en « gouache et bouse de vache » au Salon Yonnais à l’hiver 1946-1947, à Piero Manzoni, qui encapsula sa propre merde dans des boites de conserve. On connaît moins les propositions Fluxus, comme « Flux Reliquary de Geoffroy Hendricks, satire religieuse dans laquelle un distributeur automatique dispense des crottes de chat présentées comme de la "sainte merde de la Cène" », ou encore celle de George Maciunas, Excreta Fluxorum, « boîte en plastique à compartiments qui contiennent chacun des extraits d’excréments d’animaux divers : chenille, oiseau, tortue, hamster, cheval, chat, cafard, mouton, lion, antilope...7 ». Puisque Fluxus est « une bouffée d’air frais, un pied de nez à la culture sérieuse, une opposition radicale à l’art établi et à son retranchement dans ses valeurs autonomes8 », puisque les idéaux du groupe s’attachent de façon générale à piétiner les symboles d’une société bourgeoise et capitaliste, quoi de plus provocateur, de moins artistique à priori, que de la merde ? Dans le Manifeste Fluxus, Maciunas revendique une purge de la société, du monde bourgeois et de ses valeurs ; ne faut-il pas alors exposer la conséquence de ce remède ?
Exposer l’exploit des vers
Je ne suis pas sûre que Club Superette ait ce désir révolutionnaire, mais je suis sûre qu’iels sont les héritier*es de cette vision de l’art anticapitaliste et antibourgeois. Proposer les turricules comme autant de sculptures est une façon de désacraliser l’œuvre, une manière de la mettre au niveau des insectes, de la vie, de l’émerveillement enfantin face à ce que peuvent produire les êtres qui peuplent la Terre. Le collectif nous offre la possibilité d’imaginer le ver en action, de prêter attention à son exploit quotidien : contracter ses muscles circulaires et longitudinaux, allonger ses poils – appelés des soies – pour s’ancrer dans la terre, raccourcir son corps, allonger à nouveau ses muscles pour pousser la partie antérieure à travers la terre. Répéter ainsi le procédé, inlassablement. On peut penser le ver entouré de ses semblables, produisant un geste quotidien en public afin d’en révéler l’esthétique, tel un manifeste au profit de l’ordinaire et de sa réinvention. J’imagine sa bouche, son pharynx qui sert de ventouse pour tirer les aliments dans les galeries et de broyeur pour les triturer, je vois les aliments passer ensuite dans le jabot puis le gésier avant d’atteindre enfin l’intestin où est produit le complexe argilo-humique. Il paraît que la forte activité microbienne de son tube digestif permet au lombric de consommer 20 à 30 fois son volume de terre quotidiennement. Je lis également que toute la terre d’un champ passe dans l’intestin des vers en une cinquantaine d’années. Je regarde tout à coup autrement ces petits tas baroques qui collent à mes semelles : je considère la vie de ces invertébrés comme héroïque et perçois les turricules comme autant de traces de gigantesques performances jouées à l’écart du regard humain.
Baisser les yeux vers un horizon plus vaste
Club Superette nous enjoint de ne pas limiter nos investigations aux seules manifestations du visible et de l’audible, d’échapper au cadre anthropocentré qui limite notre champ d’exploration. Le titre de l’exposition forme un jeu de mot entre wormcast, « turricule » en anglais, et cast a spell, « jeter un sort » : le collectif casse ce sort qui nous aveugle, nous humain*es, afin d’être en mesure de percevoir l’immensité de la vie au-delà de notre monde propre, en vue d’être affecté*es par les œuvres non-humaines. Pour cela, la fiction et les artistes sont nécessaires. C’est ce que suppose en 1974 l’écrivaine de science-fiction Ursula Le Guin lorsqu’elle imagine l’association des thérolinguistes (néologisme dont la racine grecque « thèr » signifie « bête sauvage »). Des scientifiques y étudient la linguistique des animaux (danse des abeilles, recherche d’une sémantique dans les cris des singes...) mais aussi les littératures (poésies, épopées lyriques...). Ainsi Club Superette se place comme deux thérolinguistes amateurices à la quête des aventures labyrinthiques des vers. Le Guin n’hésite pas à user d’humour pour rappeler à quel point la science est bloquée dans ses présupposés ethnocentrés : dans l’éditorial de l’association fictive, le président se demande : « Nous-mêmes, qui sommes des animaux actifs, prédateurs, nous recherchons (et c’est assez naturel) un art de communication actif, prédateur ; et nous le reconnaissons dès lors que nous le découvrons. […] Nous ne devons pas devenir esclaves de nos propres axiomes. Nous n’avons pas encore levé les yeux vers les horizons plus vastes qui s’annoncent devant nous9 ». Peut-être pouvons-nous lire ici la réponse à la question posée plus haut (à savoir « est-ce possible de voir les turricules comme œuvre ? ») : ne jamais les regarder ou refuser de les accepter comme de l’art lorsqu’ils se présentent à nous, c’est finalement être esclaves de nos préconceptions, c’est continuer à distinguer nature et culture en cherchant à imiter la première et en la considérant comme extérieure à nous. Au contraire, en invitant les vers à exposer le fruit de leur exploit quotidien, Club Superette s’inscrit dans l’écriture d’une « Gaïahistoire », un récit où « tout ce qui n’était jusqu’alors qu’un support ou un agent passif [devient] actif sans pour autant participer à un gigantesque scénario écrit pas une entité omnisciente10 ». Les artistes dessinent des mondes communs où humain*es et non humain*es sont interdépendant*es. Haraway nomme cela « sympoïèse », soit « construire avec ». Ce terme désigne des mondes qui se forment en compagnie car, avance la biologiste, « rien ne se fait tout seul11 ». Il n’est pas inutile de préciser que les vers jouent un rôle important dans la structuration du sol : en le brassant activement, ils exercent une importante activité de bioturbation. Leurs galeries permettent à l’eau de pénétrer et aux racines des plantes de s’étendre ; leurs turricules entassent à la surface des nutriments qui participent à fertiliser les sols. Apprendre à voir cela, c’est cultiver nos « respons(h)abilités12 » et reconnaître l’interdépendance entre espèces. « Les bestioles (êtres humains compris) sont présent*es les un*es pour les autres. Mieux, elles sont – quoique jamais tout à fait – dans les tubes, dans les plis et les crevasses des unes et des autres ; elles sont à l’intérieur et à l’extérieur des unes des autres.13 » Faut-il indiquer que l’humain*e est peuplé de bactéries, chaque organisme étant indispensable à la survie de l’autre ? Ou que certaines graines ne germent qu’après être passées dans le tube digestif d’un ver de terre, lequel les dépose en surface dans le turricule particulièrement riche en nutriments pour la plante ? Ou encore que les vers de terre sont nécessaires aux artistes pour créer et penser, et que les vers ont peut-être aujourd’hui besoin des artistes pour écrire des fictions indispensables à leur survie future ?
Enchevêtrer turricules et exposition d’art est une façon de décentrer le regard vers l’imperceptible, l’activité souterraine, mais aussi d’assumer la culpabilité humaine face à la catastrophe qui ne cesse de se précipiter. Haraway rappelle que l’anthropocène est l’ère de l’urgence. « C’est une époque caractérisée par la mort et les extinctions de masse, par le déferlement des désastres et dont les aspects imprévisibles sont stupidement tenus pour inconnaissables. C’est aussi une époque de refus : refus de savoir, refus de cultiver la respons(h)abilité, refus d’être présent dans et face à la catastrophe qui vient. Jamais on n’a autant détourné le regard14 ». Club Superette ne ferme pas les yeux face à la gravité de la situation mondiale ; iels se penchent vers le sol et nous proposent d’en faire de même afin de distinguer la Terre comme un système physiologique dynamique en harmonie avec la vie, qu’il est indispensable de cultiver. Il faut inventer de nouvelles histoires pour apprendre à pratiquer les arts de bien vivre en symbiose, écrire des récits dont l’horizon est l’épanouissement plutôt que la destruction ou la paupérisation. Club Superette participe ici à imaginer des futurs possibles et à inventer des façons de vivre sur une planète abîmée. Iels donnent sens à la vie de ces champions absolus du compost, ces vers de terre anéciques constructeurs de fragiles cathédrales. Les artistes rappellent qu’il est enfin temps de les estimer, de les admirer ensemble, en compagnie de leurs auteur*es, agenouillé*es côte à côte.
1 Donna Haraway, « Une pensée tentaculaire, Anthropocène, Capitalocène, Chthulucène », dans Vivre avec le trouble, Les éditions des mondes à faire, Vaux-en-Velin, p. 66.
2 Hans Blumenberg, L’imitation de la nature et autres essais esthétiques, Hermann, Paris, 2010, p. 37.
3 Aristote, Physique II, 8, 199 a 15-17, cité dans ibid.
4 Jacques de Vaucanson, « Lettre de Mr Vaucanson à l’Abbé D. F. », Le mécanisme du fluteur automate présenté à messieurs de l'Académie royale des sciences, Paris, J. Guérin, 1738, p. 19, [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1511726m/f23.item], page consultée le 24 octobre 2024.
5Entretien avec Wim Delwoye, Psychanalyse,°29, p. 117, [file:///C:/Users/user/Downloads/entretien-avec-wim-delvoye.pdf], page consultée le 3 octobre 2024
6 Donna Haraway citée par Catherine Vincent, « Dépasser le dualisme entre nature et culture », Le Monde, 20 juillet 2020, [https://www.lemonde.fr/series-d-ete/article/2020/07/20/depasser-le-dualisme-entre-nature-et-culture_6046682_3451060.html], page consultée le 25 octobre 2024
7 Camille Paulhan, « Le retour à la terre », dans Que la bête meure ! L’animal et l’art contemporain – Hicsa/musée de la Chasse et de la Nature –INHA 11 & 12 juin 2012, [https://www.academia.edu/6775304/Le_retour_%C3%A0_la_terre], page consultée le 3 octobre 2024.
8 Nicolas Feuillie, Fluxus Dixit, une anthologie, vol.1, Les Presses du réel, Dijon, 2002, p. 5.
9Ursula Le Guin, « L’auteur des graines d’acacia et quelques autres extraits du Journal de l’Association de Thérolinguistique », dans Les Quatre vents du désir, Pocket, Paris, 1988, p. 34.
10Bruno Latour, « The Puzzling Face of a Secular Gaïa », 2013, en ligne sur youtube. Édité dans Face à Gaïa : huit conférences sur le nouveau régime climatique, Paris, La Découverte, 2015.
11Donna Haraway, « Sympoïèse, La symbiogenèse & les arts de vivre avec le trouble », dans Vivre avec le trouble, op. cit., p. 115.
12ID., « Une pensée tentaculaire [...] », dans op. cit., p. 65.
13ID., « Sympoïèse [...] », op.cit., p. 190.
14ID., « Une pensée tentaculaire[...] », dans op. cit., p. 67.



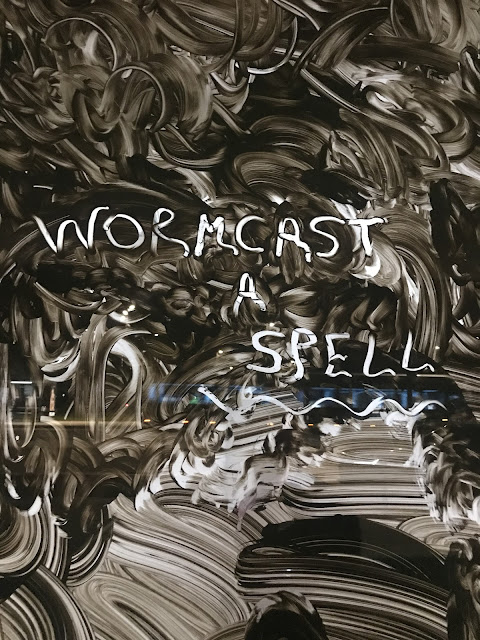



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire